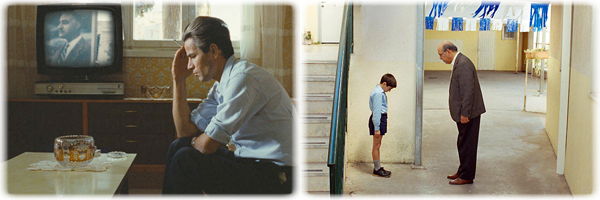Avec ‘le
temps qu'il reste’, troisième
d'une trilogie composée de ‘chronique
d'une disparition’ et ‘intervention
divine’, Elia
Suleiman se penche sur son histoire familiale
à Nazareth, liée avec l'Histoire avec un grand H.
Après un prologue où un taxi ramenant le
réalisateur / acteur au pays se perd dans une nuit d'orage
sur des échangeurs complexes, on passe en 1948, lors de la
constitution de l'Etat d'Israël, concrétisation
d'aspirations du début du siècle. C'est le temps
de la dépossession, de la reddition et des trahisons. A
l'échelle du film, c'est la prise de connaissance de Fuad
Suleiman, futur papa de Elia. Suivent
d'autres épisodes de la vie familiale, des scènes
de la vie quotidienne, des anecdotes sur différentes
époques, jusqu'à arriver aux temps contemporains.
Avec ce film, Elia
Suleiman continue son travail de
mémoire sur sa famille, avec un regard attachant et
émouvant sur ses parents. Sa mère qu'il a
filmé dans les deux premiers long-métrages, a
entre temps disparue. C'est ici une vielle dame qui l'incarne
à l'écran dans ses vieux jours. Quant
à son père est interprété
par Saleh Bakri
que l'on avait vu en séducteur dans ‘la
visite de la fanfare’. Hors mis bien entendu
l'enfance et l'adolescence, Elia
Suleiman endosse son identité ; une
présence particulière, souvent comme
étrangère, absente (si l'on peut ainsi qualifier
une présence), à l'image de la
"condition palestinienne", tout en étant
impliqué, les yeux grands ouverts. Il faut
également parler des lieux du film,
déjà familier dans les
précédents volets (l'appartement familiale, avec
son escalier, son balcon ...), qui traversent les époques.
Côté formel, Elia Suleiman
utilise un langage plus visuel que parlé, avec un humour
basé sur des situation (d'où ses filiations avec Keaton et Tati). Il
joue sur la répétition de situations identiques
(scènes de pêche, de suicide raté d'un
voisin fin stratège par ailleurs), avec une
caméra fixe qui laisse place au hors champs. Quelques
"running gag" viennent également ponctuer le film (voir la
scène du char pointant un habitant au téléphone).
Simplement, sans mots, il réussit à rendre des
émotions complexes, comme la magnifique scène
où sa mère n'apprécie guère
un feu d'artifice avec ses détonations qui lui rappellent
d'autres souvenirs ...
Elia
Suleiman avec son langage singulier
témoigne son affection et son amour à ses
parents, et rend compte de la difficile communication (voire
d'incompatibilité) entre les différents habitants
d'Israël, du sentiment de déracinement des siens
qu'ils émigrent (voir à ce sujet le magnifique ‘Amerikka’
de Cherien Debis)
ou qu'ils restent. A ce sujet, il ne faut pas regarder ce film comme
une retranscription historique, une parole unique sur le sujet dans son
ensemble, mais un témoignage sincère d'une
partie. A noter tout de même quelques notes d'espoirs
délivrés par la musique ou le cinéma
ici ou là ...

|